Accueil > Claude Simon > Œuvres > Le Tricheur (1945)
Le Tricheur (1945)
samedi 11 octobre 2025, par
Le Tricheur (1945). Notice
par Alain FROIDEVAUX
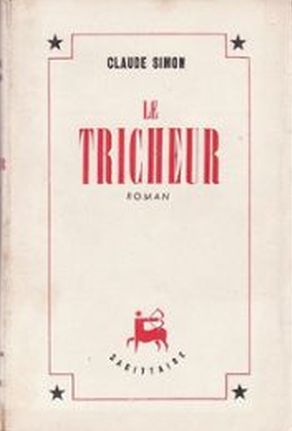
Préambule
Avec Le Tricheur, achevé en 1941, publié en 1945, se jouerait, selon Marie-Odile André, une sorte de « mise en scène de l’acte » d’entrée en écriture du romancier débutant. Dans ce premier essai que les Éditions de Minuit rééditent aujourd’hui avec La Corde raide (1947), on retrouve tout à la fois les questions sur le sens de l’existence qui imprégnaient l’époque et les prémices d’une recherche poétique que Claude Simon ne cessera de remettre en jeu de roman en roman.
Résumé
Louis, orphelin d’un père tombé au champ d’honneur pendant la guerre de 14 et d’une mère emportée par le cancer alors qu’il était enfant, et Belle, fille de Catherine et de Gauthier, un artiste peintre rescapé de la Grande Guerre, cheminent ensemble. Dans la lignée des romans d’apprentissage, entre souvenirs douloureux d’un passé qui leur colle à la peau et réalisation d’un avenir incertain, chacun des deux jeunes gens cherche pour son propre compte à donner du sens à son existence. Leur route croise celle de quelques autres personnages : Ephraïm, vendeur de montres et lecteur à ses heures du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir ; Armand, un plombier qui commet des petits délits afin d’arrondir ses fins de mois, en se jouant d’un représentant de la loi ; sa femme Thérèse et Lydie, leur nièce un peu délurée. Sans oublier un prêtre rencontré par hasard et que Louis en vient à tuer sans pouvoir être certain de l’avoir voulu. D’une manière ou d’une autre, tout le personnel romanesque du Tricheur exemplifie l’épigraphe que ce roman polyphonique emprunte au dictionnaire Littré à l’entrée « hasard » : « corriger le hasard, tricher au jeu ».
Analyse
Un roman de la représentation psychique
Déconcertante à première vue, la composition du Tricheur entremêle à l’enchaînement des actions de personnages plongés dans leurs réflexions un passé qui ne cesse de se rappeler à eux. Les formes qu’adopte le romancier pour représenter la vie psychique de ses personnages tendent aussi à associer le discours mental des personnages à celui du narrateur.
Dans ce récit, le temps de l’action semble en quelque sorte « sorti de ses gonds ». À l’exemple de Quentin, l’un des descendants de la famille Compson du Bruit et la Fureur de Faulkner, l’une des premières actions de Louis consiste à se débarrasser de la montre de son père reçue en héritage : un geste qu’aussitôt il regrette. À ce legs paternel qui pèse sur les pensées de Louis, viennent s’ajouter les dernières volontés de sa mère qui lui a intimé le devoir de devenir un homme à l’exemple de son père, en se faisant militaire de carrière ou prêtre, s’il peut en être digne. Constamment inquiet, Louis, « remâcheur de passé », se demande comment parvenir à se délester d’un héritage aussi lourd et se donner une chance d’être pleinement soi-même. Cette inquiétude le poursuit jusqu’au moment où il s’apprête à couper les amarres avec « toute la somme d’absurdités » qui constitue sa vie : il hésite entre supprimer ou laisser vivre les assignations de ses parents disparus. De leur côté, Belle, Catherine et Gauthier, eux aussi, ne cessent de mélancoliquement fluctuer entre velléités d’affirmer leur existence et incertitude d’exister. Ils sont comme ce morceau de bois emporté par le courant « qui ne flotte que parce que sa densité est faible. […] Et c’est cela que l’on appelle lutter et vaincre : des débris et des hasards », observe Louis en se promettant de se démarquer de ce genre d’existence.
« Corriger le hasard »
Belle reconnaît volontiers la part du hasard dans sa décision de partir avec Louis. « Je me souviens que j’ai pensé : “Si le troisième homme qui rentre dans le café a un chapeau, ça réussira’’ ». Pour rester indépendante et ne pas risquer d’être malheureuse en ménage comme sa mère, Belle est tentée par l’idée de parier aux courses hippiques, tout comme son oncle Jacques qu’elle déteste.
Accablée par le souvenir d’une « faute imposée par le destin », sa mère, Catherine, a perdu la foi mais c’est de Dieu qu’elle attend d’être libérée du poids de sa culpabilité après s’être donnée contre son gré à un jeune aviateur, dans un moment où elle ne savait pas si Gauthier, tombé au front, était encore vivant. Rescapé, Gauthier, quant à lui, entend reprendre sa place dans le monde des vivants. Tout en pédalant sur son vélo, il rêve « de se pencher […] hors des œillères de l’équilibre » et il se laisse tomber avec l’idée de réaliser « quelque chose qui les étonnerait tous, simplement parce qu’il suffisait de vouloir et de jeter la raison par-dessus bord ». Cette chute en répète une première sur les champs de bataille dont il est parvenu à se relever indemne par le plus grand des hasards. Il repense à sa chance puis songe à la chute dans l’Etna d’une figure légendaire telle celle d’Empédocle.
Ayant l’intention de se démarquer d’une « conception de l’existence sous l’optique du pari mutuel » que Belle partage avec le commun des mortels, Louis est tenté de l’abandonner en chemin. Il se remémore un différend avec un ami à propos de la question du libre arbitre et d’un acte propre « “à faire la preuve que l’on a été, que l’on est, autre chose qu’une suite de loteries …’’ ». La possibilité d’un tel acte se précise lorsque le hasard le conduit à intervenir en tant que plombier au domicile d’un prêtre. C’est alors qu’il décide de tuer celui-ci. N’ayant pu acquérir un revolver, il emprunte celui de son collègue Armand sous prétexte de faire une farce à un ami et revient chez le prêtre « pour en finir ». Louis se tient alors comme à distance de lui-même, tel un spectateur connaissant par avance l’issue d’une tragédie. Prétextant un besoin pressant, Louis « [s]’arrête comme pour pisser contre [un] tas de briques tandis qu’il [le prêtre] continue de son pas tranquille ». Il se saisit d’une de ces briques, qui semble tombée du ciel, et frappe l’homme de Dieu par derrière. De retour auprès de Belle dans leur chambre d’hôtel, Louis s’aperçoit que l’arme qu’il avait d’abord choisie pour agir est restée sans emploi dans son veston : « Et alors seulement je me rappelle la forme pesante de ma volonté, oubliée, inutile et dérisoire, dans ma poche. »
Corriger les règles du jeu propres à la fiction
À la suite de Maurice Nadeau en 1946, la critique de ce roman s’est employée à envisager les raisons de la résolution de l’intrigue du Tricheur où la volonté de Louis se trouve mise en défaut par quelque facétieux deus ex machina. Jean-Yves Laurichesse a souligné que le nœud de l’intrigue était « déterminé par l’histoire personnelle de Louis et singulièrement son enfance ». On peut en effet interpréter la violence du passage à l’acte de Louis devenu un sujet qui cherche « à sortir du décor » en l’associant au souvenir lancinant de la volonté maternelle qui l’assigne à devenir prêtre ou soldat comme son père : « “Sois toujours digne de lui, il aurait voulu faire de toi un homme’’ ». En un sens, l’acte que commet Louis peut s’entendre comme une violence que le sujet s’inflige de manière à supprimer l’ombre portée d’un surmoi envahissant.
Assassinat, meurtre, quel que soit le terme propre à qualifier l’acte de Louis, on peut encore envisager cet acte manqué « aux accents de parricide » (Pascal Mougin) sur un autre plan, comme l’expression d’une certaine forme d’auto-ironie du romancier au moment de parachever le roman. Anthony C. Pugh, par exemple, démontre que « le meurtre du Tricheur » ne relève pas tant d’un « acte gratuit » (à l’exemple de celui que commet Lafcadio dans Les Caves du Vatican de Gide) ou de quelque protestation nihiliste contre « l’absurde », mais qu’il « constitue la très logique conséquence d’un jeu textuel ». Le récit rétrospectif que Louis fait de sa confrontation avec l’homme de Dieu commence par revenir sur le moment où le prêtre l’accueille au presbytère : « Il était probablement en train d’écrire ». C’est donc une figure d’écrivain que Louis s’apprête à tuer. Le récit se poursuit en insistant sur l’impression de dédoublement que ressent le visiteur sur le point de passer à l’action. « C’est comme si je sortais de moi […] Aussi sûrement qu’un spectateur qui connaît les fils de l’intrigue, au théâtre, et qui sait, assistant à la scène, laissant l’acteur qui va faire ce que je sais et lui en face qui ne sait pas […] ». Cette distance d’un spectateur qui connaît par avance le dénouement d’une tragédie ne reviendrait-elle pas en quelque manière à la classique décantation aristotélicienne des passions ?
Didier Alexandre envisage pour sa part le dénouement du Tricheur « comme le meurtre d’une forme romanesque dominée par la volonté de Dieu, métaphore du narrateur omniscient » ou d’un romancier réaliste, ambitionnant, comme Flaubert, de demeurer caché derrière ses personnages, pour se tenir dans son œuvre « comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ». Ce travail, le premier roman de Simon le délègue in fine à Louis et à la brique de circonstance que le romancier lui met à portée de main au moment d’éliminer le prêtre dont le visage reste dissimulé par l’ombre de son chapeau, alors que les protagonistes déambulent sous l’éclairage public d’un réverbère. Ainsi, la chute de ce premier roman opèrerait déjà une sorte de déconstruction de la figure du romancier omniscient, tout en préparant le chantier rénovateur d’un édifice romanesque dans lequel un écrivain questionne la possibilité de représentation du réel. Dans le récit de Louis, un terme revient sans cesse : « Idiot ». Ce terme autour duquel Louis tourne en boucle n’exprime-t-il pas exactement l’idiotie d’un réel sur lequel bute toute velléité de le représenter dans la fiction ?
Entre tragique et dérisoire, la tricherie comme motif poétique essentiel
Peu avant de passer à l’acte, Louis remarque cinq jeunes garçons en train de jouer à prendre et à défendre comme des petits soldats un tas de sable. Il observe que ces enfants, « dupes de la fiction par eux imaginée, source d’âpres et véhémentes discussions » s’ingénient « inconsciemment à détruire leur jeu » en enfreignant les règles qu’ils s’étaient données. À la fin « il y a eu une sorte de calme embarrassé où les vainqueurs foulant au pied le tas de sable conquis semblaient un instant désemparés, comme s’ils percevaient la vaine inutilité de leur victoire ». On peut voir, derrière ces enfants, le romancier naissant un peu désabusé au moment de conclure son roman d’apprentissage : il renonce, en même temps qu’au coup de feu tiré, à rapprocher Louis de Julien Sorel (Ephraïm, l’un des personnages du Tricheur, semble lire avec passion Le Rouge et le Noir).
Claude Simon, à l’en croire, est un romancier qui manquerait d’imagination. Au moment de la parution de L’Acacia en 1989, il déclare à Marianne Alphant, que dès Le Tricheur, tous ses romans sont « à base de vécu » : « S’il y a une évolution sur ce plan dans mon œuvre, [c’est] la disparition progressive du fictif […] ». Enfance d’un orphelin mis en pension au collège, maladie et mort de la mère, vaine recherche de la tombe du père, cartes postales que Louis envoie à Belle de l’autre bout du monde, mésalliance entre une famille titrée et une famille d’instituteurs qui ne l’est pas : tout cela ressort bel et bien du fonds personnel de l’écrivain. S’y intègrent aussi des bribes de souvenirs de Renée Clog, son épouse depuis 1940 : « fuite de Renée et de sa mère dans la nuit. Le père ivre. La hache. La valise. Accueil chez la grand-mère. Menaces du grand-père au père. Les frères de la mère qui vont rosser le père dans un bistrot. » Tous ces motifs qui entrent dans la matière du Tricheur, l’écrivain n’aura de cesse de les remettre sur le métier tout au long de son œuvre.
Découvrir Claude Simon en commençant par Le Tricheur permet de prendre la mesure des recherches poétiques d’un écrivain soucieux de conférer une crédibilité esthétique à chacun de ses textes en explorant les diverses strates d’une mémoire textuelle pour faire œuvre. Ainsi, la tricherie est un thème que l’on retrouve diversement travaillé jusque dans L’Acacia. Dans La Corde raide (1947), un texte aux accents autobiographiques qui fait suite au Tricheur, la tricherie ou le truquage désigne la manière dont les peintres expriment leur « vision idéale du monde […] basée sur une conception, ou plutôt une morale de l’univers visible, ou même, ce qui est plus grave pour des peintres, une morale tout court ». En revanche, le personnage du Sacre du printemps (1954) préfère au « mot tricherie impliquant l’idée de jeu et celui de jeu de gratuité », celui d’imposture pour qualifier au mieux son investissement dans l’action révolutionnaire et son implication dans un transport d’armes destinées aux forces républicaines lors de la guerre civile espagnole. Une autre façon de tricher, celle de Georges dans La Route des Flandres, consiste à tricher avec soi-même, ainsi lorsqu’il a continué à suivre jusqu’au bout son capitaine en pleine débâcle. C’est aussi le reproche que fait l’écrivain des Géorgiques à O. qui raconte son engagement « comme s’il était question d’un autre que lui et de choses allant de soi, reflétant cette espèce de candeur, de subtil mélange de tricherie et de naturel qui est de règle dans les pugilats disputés autour d’un ballon [...] ». Enfin, dans ses notes préparatoires pour L’Acacia (1989), l’écrivain esquisse le portrait du jeune homme qu’il était avant-guerre, à l’époque de la mise en route du Tricheur, sous les traits d’un « faux étudiant à Cambridge », « faux cavalier (presque riche) à Lunéville », « faux révolutionnaire », « faux guerrier-prisonnier-travail physique ». Dans le roman, il développe l’évocation d’un étudiant en cubisme affectant des convictions politiques « qu’il n’était pas lui-même très sûr d’approuver », « trichant donc aussi avec lui-même (c’est-à-dire trichant à moitié, c’est-à-dire dans la proportion où ce programme philosophique de suppression des banques ne le séduisait qu’à moitié) ».
L’écrivain de L’Acacia montre ainsi, quarante ans après, combien cette figure du « tricheur » est essentielle à sa thématique et au double jeu propre à la fiction et à l’autofiction au cœur de nombre de ses romans.
Repères
- Le Tricheur, Paris, Le Sagittaire, 1945, 250 p.
- Le Tricheur, Paris, Minuit, 1957.
- Le Tricheur et La Corde raide, Premières œuvres 1945-1947, Minuit, 2025, 451 p.
Autres oeuvres
- Œuvres, Édition établie par A. B. Duncan et J.H. Duffy, Gallimard, « La Pléiade », 2006 et Œuvres II, Édition établie par A. B. Duncan et B. Bonhomme et D. Zemmour, Gallimard, « La Pléiade », 2013.
Articles
- ANDRÉ (Marie-Odile), « Entrée trichée : à propos du premier roman de Claude Simon », Claude Simon : situations. Lyon : ENS Éditions, 2011.
- LAURICHESSE (Jean-Yves), « Claude Simon avant le Nouveau Roman : un après-guerre », Littératures, 82, 2020.
- PUGH (Anthony C.), « Du Tricheur à Triptyque, et inversement ». Études littéraires, 9(1), (1976), 137–160.
- PIQUER DESVAUX (Alicia), Notice Le Tricheur, Dictionnaire Claude Simon, Textes réunis par Michel Bertrand. Paris : Honoré Champion, 2013, tome 2, p. 602-604.
- SCHOENTJES (Pierre) « Nature et mouvement dans Le Tricheur », dans Jean-Yves LAURICHESSE (dir.), Les premiers livres de Claude Simon (1945-1954). Revue des Lettres modernes, Série « Claude Simon », n°7, Classiques Garnier, 2017, p. 23-39.